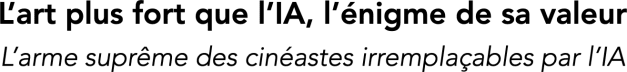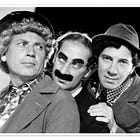La valeur extravagante d'un cinéma à réinventer: le principe de Lucifer (2/3)
Tout est à repenser dans le cinéma pour retourner l'arme de l'IA. Des créateurs audacieux peuvent réinventer une valeur déstabilisante à l'échelle, et leur révolution va rebattre les cartes...
Voici le deuxième épisode (2/3) de ma fiction sur l’avenir de la valeur intellectuelle du cinéma. À qui appartiendront les films d’un cinéma forcé de se réinventer pour survivre ? Que se passe-t-il quand l’échelle de l’IA rebat totalement les cartes de la création de valeur ?
Ne manquez pas l’occasion de faire vibrer votre palpitant dans l’ordre: lisez ici mon premier épisode pour capter la force démoniaque du cinéma des Marx Brothers.
Armez-vous de la force créative de rêver: le principe de Lucifer.
Dans cette fiction, je développe cette idée freudienne: on sait que notre inconscient produit des rêves, une forme de cinéma onirique à la Fellini. Depuis 2 millions d’années, le pouvoir onirique de l’écriture de ces récits par notre cerveau nous fait progresser en retour. C’est le secret de l’intelligence supérieure de Sapiens, un principe diabolique. Si ces récits de notre psyché sont capables de provoquer des jouissances collectives, s’ils peuvent réveiller les morts, ne pourraient-ils pas ressurgir demain tel des diables de leur boite ? Et si les 3 révolutions créatives de l’humanité, combinées avec la puissance de l’IA et mon principe de Lucifer, prenaient un essor diabolique ?
Comment Hitchcock a forgé ce principe démoniaque ?
Explorons les mystères de ce grand paradoxe de l’histoire de l’art, ce principe de puissance des récits inspirés par Lucifer. Appelons le principe de Lucifer pour faire court, et voyons avec Hitchcock comment il fonctionne. On a vu que les clés secrètes de la première révolution cognitive de Sapiens, celle de l’intensité créative si puissante de l’art des récits chantés et dansés - le cinéma de l’époque, remonte à 2 millions d’années. Cet art des transes musicales les plus anciennes est si puissant qu’il a le pouvoir, encore aujourd’hui de “réveiller les morts”. Ce principe créatif provoque encore des “jouissances musicales collectives hors normes”; elles sont mesurées par la science. Découvrez dans cette note1 pourquoi des chimpanzés, parfois plus malins que nous, en jouissent aujourd’hui pendant des heures le long des rivières.
La seconde révolution fut celle de Gutenberg ou les récits imprimés sont passés à l’échelle mondiale; cela n’a pas cessé d’augmenter la valeur de l’art et de la science (Renaissance, propriété intellectuelle,…). La troisième révolution technologique, celle de l’IA, commence à peine à produire ses effets. Ils vont tous nous surprendre, pourquoi ? Parce que son échelle est exponentielle, chaotique.
C’est alors que mes héros parviennent enfin à combiner les 3 révolutions de l’histoire à l’échelle exponentielle. Dit autrement, avec une décentralisation technologique qui galope avec l’IA, avec de nouvelles règles de l’art, ils révolutionnent la valeur intellectuelle. Voici leur magie noire: avec un nouveau processus créatif, leurs films accèdent à une nouvelle échelle de valeur (découvrez les 8 clés secrètes ici).
Sur 2025-2045, on peut s’attendre à une guerre sans fin sur le contrôle des films du futur, celle d’un monde chaotique où les créateurs se battent pour devenir enfin souverains. D’après vous, qui détiendra la valeur intellectuelle future ? Des créateurs souverains ou des dirigeants qui ne prennent plus aucun risque ?
La structure fractale du récit hitchcockien
Passons à l’action: on filme ! Je vous parle de mes émotions de cinéphile, je tente de rentrer dans la pensée d’Hitchcock. En quoi réside son pouvoir de Lucifer ? Quand je regarde “La Mort aux Trousses”, ce maitre du suspense me captive, me capture corps et âmes dès la première scène du film.
Comment fait-il pour redoubler l’intensité dramatique - l’émotion qu’il me suscite, de scène, en scène, de séquence en séquence ? Comment parvient-il à s’emparer de ma pensée pour ne me relâcher que dans la mise en abime (scènes finales) ? On comprend ici que la puissance des règles de l’art d’Hitchcock réside dans la structure fractale de son récit. Une fonction fractale ressemble graphiquement à un choux de romanesco: elle suit une échelle exponentielle parce que sa structure se répète à chaque changement d’échelle : à chaque zoom, la taille des motifs se réduit d’un facteur constant, et le nombre de motifs croît ainsi selon une loi de puissance ou exponentielle.
Dans ce récit de structure fractale d’Hitchcock, le motif « personnage–objectif–obstacle » se répète à toutes les échelles (scène, séquence, totalité), chaque itération augmentant le conflit et resserrant l’unité, ce qui fait croître l’intensité de scène en scène et permet de « passer à l’échelle ». Ce faisant, on peut multiplier ces couples objectif–obstacle jusqu’à l’exponentiel. Dans la “Mort aux Trousses”, chaque micro-course-poursuite réplique le sprint global du film. Ce film suit précisément mes 8 règles de l’art du récit dramatique. Il est construit selon 3 segments (scène, séquence, chapitre) qui seront encore étudiées, analysées, disséquées dans 100 ans. Je me suis inspiré de ce dossier des Cahiers du Cinéma de 20252 rédigé plus de 65 ans après le succès du film (1959).
Dans son livre “Le principe de Lucifer3”, Bloom nous invite à une exploration scientifique dans les forces de l’histoire. Ce sont des forces de rivalité, de quête identitaire, opérant à tous les niveaux du vivant et des sociétés depuis qu’elles développent des récits. Bloom remonte, comme moi, à l’origine humaine des récits chantés et dansés. Mes 8 règles de l’art du récit sont donc alignées avec les siennes: il s’agit du pouvoir de la transcendance (une clé du dépassement), celui aussi du pouvoir de trouver sa singularité (une autre clé artistique) dans un groupe tout en étant façonné par lui. Dans le premier épisode (1/3), on a montré comment ces règles de l’art ont conduit à forger les 3 grandes révolutions de l’histoire (Sapiens/Gutenberg/IA).
Quelle sont les échos de ce principe dans la construction du récit par Hitchock ?
L’anonymat et la singularisation forcée : Thornhill, homme quelconque, est précipité dans un engrenage où il va devoir affirmer son existence, sortir du troupeau ("homme de la foule", "pris pour quelqu’un d’autre"). Chaque fuite, chaque menace le pousse à devenir quelqu’un, à affirmer sa singularité alors même que tout semble conspirer à le faire disparaître ou le diluer.
La rivalité et la double face, l’effet miroir (autre clé artistique). La lutte pour la survie est aussi une lutte entre masques : le faux et le vrai, l’innocent accusé, la trahison, les faux-semblants (Eve Kendall, double agent). L’énergie du principe de Lucifer est ici celle du chaos, du bouleversement de l’ordre, du renversement des identités.
Le système, la horde et l’individu : le film met en scène des puissances collectives – la CIA, la "horde" des espions, le pouvoir anonyme – à qui s’oppose la volonté de l’individu de survivre, de “remplir" sa coquille vide par le récit de sa propre aventure.
Le chaos comme moteur créatif : tout le récit est une succession de perturbations, de ruptures, où le désordre (le quiproquo, la poursuite absurde, la fragmentation narrative) devient le moteur du renouvellement, de "l’éveil" du personnage et du spectateur.
Roger Thornhill est, malgré lui, la figure luciférienne : chassé du confort du collectif, il erre pour affirmer sa présence – c’est "la chute" qui génère le mouvement, la révolution de l’identité, du récit, du regard. Chaque séquence est une micro-révolution où le héros doit ruser, combattre, manipuler ou échapper, incarnant la dynamique fondamentale du film.
Quand l’intensité créative d’un film ne cesse d’augmenter, sa valeur aussi.
À chaque étape de “La mort aux Trousses”, le protagoniste, Roger Thornhill, affronte le même schéma : être pris à tort, être menacé, devoir trouver la vérité, se confronter à une instance du "père" ou du pouvoir, puis redémarrer la quête, parfois transformé. Je cite les Cahiers du Cinéma « Thornhill ne sait rien, il incarne un fantôme », puis « son parcours forme un circuit symbolique le conduisant à quitter une mère possessive, affronter des figures paternelles et trouver l’Eve idéale » ).
Je caractérise ce récit fractal par une structure où chaque segment (scène, séquence, chapitre) reproduit à petite échelle la dynamique, la forme, le rythme ou les motifs du récit dans son ensemble : un jeu de miroirs entre le tout et les parties.
“La Mort aux Trousses” est construite autour d’un parcours géographique et initiatique, rythmant le récit en stations topographiques (New York, Chicago, Rapid City/Mont Rushmore), chacune avec ses satellites (la plaine désertique, la salle des ventes, la maison de Vandamm).
Ce découpage en étapes régulières (environ toutes les 20 minutes, un changement majeur ou une révélation) produit un rythme cyclique et fractal : chaque grande partie contient ses propres cycles de tension, de poursuite, de révélation.
Les scènes emblématiques (par exemple l’attaque de l’avion, la séquence du Mont Rushmore) déploient à l’échelle réduite les motifs du film : le déplacement, la menace invisible, l’identité en jeu, la lutte pour la survie et la révélation de la "vérité".
La dynamique de savoir est aussi fractale : le spectateur et Thornhill avancent ensemble (jeu de miroirs), l’un ignorant ce que sait l’autre (ironie dramatique), puis l’information circule en boucles, jusqu’à la jonction.
Enfin, le motif du MacGuffin (l’objet vide – Kaplan, la statuette) se duplique à toutes les échelles : ce que poursuit chaque personnage, comme le spectateur, est toujours sujet à déplacement et renouvellement cyclique.
Voici le secret de ce principe de renforcement de la valeur dit de Lucifer: la valeur d’un film se constitue dans l’esprit de ceux qui le regarde, et qui progressent de concert avec l’auteur dans un puissant cycle de renforcement des capacités. Quand les 8 clés de création du-dit film ne cessent d’augmenter la valeur à une plus grande échelle, la valeur intellectuelle du film augmente en retour.
Et si des mots réveillaient l’esprit de Truffaut et de l’enfer totalitaire de Bradburry ?
Dans ma prochaine lettre sur l’avenir du cinéma (3/3), je passe à l’écriture d’une nouvelle avec mon principe de Lucifer. Mes héros seront un metteur en scène inspiré de Truffaut et un écrivain de la trempe de Ray Bradburry, l’auteur du roman “Farenheit 451”. Dans cette dystopie, “Farenheit 451” désigne la température à laquelle un système totalitaire fait brûler les livres. Ce qui ne manquera pas d’arriver avec le totalitarisme du “Tout IA” qui monte. Voici l’affiche du film dont je m’inspirerai
Réalisez vos rêves, même les plus fous !
“Que la valeur intellectuelle reste, enfin, là où elle est née!” Le rêve exprimé par Balzac qui voulait maitriser toutes les composantes de SA propriété intellectuelle.
Ce monde de cinglés dans lequel nous rentrons est celui de Trump, de Vance, et de leur “Tout IA. Un monde où leur lavage de cerveau est passé à l’échelle: ils imposent leur vérité. Comme avec Trump dans l’Amérique d’aujourd’hui, plus personne ne peut distinguer le vrai du faux, puisque tout bon autocrate nous inonde de son récit de cinglé, totalement trafiqué. Dans cette société, on brûle les livres et les auteurs qui ne plaisent pas à Trump, à son successeur, ou à l’autocrate qui ne manquera pas de diriger la France bientôt.
Mais si une jeunesse a le courage de résister, et le pouvoir de réinventer la valeur intellectuelle du cinéma et de l’art, je garde de l’espoir. En tout cas, je ferai tout pour l’aider avec le pouvoir de ma petite plume. Pas vous ?
David Jamet, auteur et chercheur - david@livre-contre-ia.fr
Dans son livre “Music to raise the dead”, Ted Gioia (“The Honest Broker”), mentionne cette expérience scientifique mesurant le plaisir des chimpanzés restant des heures au bord d’une rivière à écouter la musique de l’eau.
Vous pouvez lire ici ce dossier des Cahiers du Cinéma de 2025 sur “La Mort aux Trousses”
Howard Bloom, “Le principe de Lucifer” est un livre passionnant. Il s’agit d’une exploration scientifique dans les forces de l’histoire. Je vous le recommande.